Genré.e
La pensée est-elle « genrée » ?
La question est stupide, mais beaucoup
de féministes, de wokistes, de penseurs politiquement corrects se la posent
quand même.
Quand je lis Blaise Pascal ou Simone Weil, est-ce que je m’interroge sur
leur sexe ? Est-ce que leur genre a déterminé leur réflexion ? Est-ce
que je tiens compte de leur masculinité ou de leur féminité (relatives) pour
juger de ce qu’ils m’apprennent ? Si je me pose la question, je suis sur
la voie de l’égarement.
Traditionnellement, on disait que les hommes étaient surtout rationnels
et les femmes plutôt sensibles. L’a priori a fait long feu ; alors on a
tenté de dépasser cette distinction binaire. Tous les cerveaux se ressemblent, a-t-on
commencé à reconnaître. Mais voilà que quelques radicaux (quelques radicales),
né.e.s de la dernière pluie, veulent nous convaincre que la production
intellectuelle féminine est quand même différente de la production
intellectuelle masculine*. On se raccroche toujours à « sa »
différence.
Là où le problème s’aggrave, c’est que la production artistique des
femmes d’aujourd’hui (littérature, théâtre, cinéma, arts visuels) paraît
exclusivement centrée sur le thème de la « condition de la femme ».
Est-ce que leurs prédécesseurs, c’est-à-dire les artistes hommes d’antan
écrivaient d’abord sur leur condition masculine ? Je n’en vois aucune
trace dans le théâtre de Shakespeare, par exemple, et je le connais bien. Les
autrices à venir auront vraiment gagné leur indépendance quand elles parleront enfin
d’autre chose que d’elles-mêmes.
Les auteurs et les autrices sont tous des auteurs. La seule différence
qui compte est de savoir s’ils sont bons ou non.
* Voir le dernier ouvrage de Carol
Gilligan, Une voix humaine, chez Flammarion.

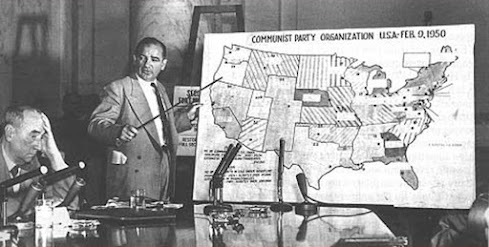


Commentaires
Enregistrer un commentaire