Shakespeare
Comme un roman
En ce printemps de
1595, William Shakespeare donne, avec la troupe du Grand Chambellan, pour
l’ouverture de la nouvelle saison théâtrale, la première représentation de La
Nuit des rois. Il n’est pas un nouveau venu au théâtre. Auteur aguerri
autant qu’habile metteur en scène, il connaît les goûts du public londonien et
en joue avec bonheur. Depuis La Comédie des erreurs, il s’intéresse au
thème des doubles et des jumeaux, et il sait en tirer des pièces à succès. Il
se sert, pour le ressort de sa nouvelle comédie, d’une des conventions les plus
contraignantes de l’art dramatique de l’époque, celle qui interdit aux femmes
de monter sur scène et qui oblige à ce que tous les rôles féminins soient tenus
par des hommes (le plus souvent, des adolescents). Shakespeare en profite pour
multiplier les situations comiques, dont le public raffole : il lui suffit de
savoir jongler avec la confusion des sexes. Shakespeare sait qu’il peut compter
sur un acteur parfait pour le rôle central, un acteur très sûr de sa technique malgré son âge : celui qui avait tenu le rôle de
Juliette à 14 ans, joue à présent Viola à 16 ans. Sa voix n’a pas véritablement
mué, son visage est encore imberbe.
Qu’est-ce qui est le plus fascinant : le
personnage de Viola qui se fait passer pour un garçon, ou l’acteur dans le rôle
de la fille ? La pièce ne
« fonctionne » que dans la mesure où les spectateurs croient
sincèrement aux transformations successives du personnage.
Au cours de la représentation, de son poste
d’observation, le dramaturge examine son auditoire et il enregistre ses
réactions. Les visages réjouis, au parterre, le comblent de joie. Les gens
rient, puis se taisent, puis ils sursautent et crient, tout va bien. William observe
aussi, avec appréhension, tous ses rivaux assis dans la pénombre des galeries,
tous ces prétendus auteurs de théâtre qui pullulent à Londres, tous les
histrions à qui il fait de l’ombre, tous les rimeurs jaloux de son succès qui
sont prêts à le dévorer d’une dent cruelle. Ils sont venus pour détester la
pièce et ne manqueront pas de la trouver mauvaise. Plus leurs mines
s’allongent, plus William se délecte. Il aperçoit aussi, en parcourant du
regard les galeries bondées, un peu à
l’écart, Emilia Lanier, sa maîtresse depuis peu. Elle fréquente les
milieux cultivés de Londres et est très friande de théâtre. Elle rit, elle
tremble, elle est captivée... William en éprouve une satisfaction toute
particulière. Il adore séduire.
À la première galerie, aux places d’honneur,
parmi ses bienfaiteurs, se trouve le comte de Pembroke, deuxième du nom. C’est
un grand gentilhomme généreux, protecteur de Shakespeare et de sa troupe. Son
contentement est manifeste et cela satisfait l’homme de théâtre qui pense à sa
recette, à ses comédiens, aux pièces encore en chantier, à la tournée probable
de l’automne 95. Tout absorbé par ses responsabilités, encore un peu sous
l’effet du trac, William n’a pas vu le jeune homme étonné qui se tient à côté
du vénérable aristocrate, un adolescent à la mise élégante, le fils du comte.
La pièce s’achève. Les applaudissements
crépitent et se prolongent. Après que la foule est sortie de l’enceinte du
théâtre, dans le silence retrouvé de la salle en plein air où les voix
résonnent sans provoquer de véritable écho, alors que les dernières lueurs du
jour faiblissent au-dessus de Londres, le comte de Pembroke vient en personne
féliciter son protégé. Le gentil Shakespeare en rougit, sans forcer sa modestie
connue de tous. Au milieu des éloges, presque incidemment, le comte présente à
l’artiste en vogue son fils, William Herbert, l’adolescent étonné de tout à
l’heure. Le jeune aristocrate salue gracieusement l’homme de théâtre, il lui
sourit avec un naturel délicieux et candide. Shakespeare, pressé par ses
obligations mondaines, n’a pas le temps de répondre aux salutations aimables du
jeune comte, il n’a qu’un sursaut et éprouve un frisson incontrôlable devant le
sublime jeune homme : mon Dieu, qu’il est beau ! Comme il est bon acteur, ou
par stricte convenance, il ne laisse rien paraître de son trouble. Il répond
aux salutations du jeune éphèbe par des compliments d’usage et reprend la
conversation avec son père.
Sans qu’il s’en doute, William Shakespeare vient de faire la rencontre la plus imprévue et la plus déterminante de sa vie. Le « jeune homme des Sonnets » vient de lui apparaître. Il se prénomme William, comme lui, il a 15 ans, avec son abondante chevelure blonde qui lui tombe sur les épaules, il est beau comme une fille, et il le sait. Avec son père, il commence à fréquenter le monde et il va bientôt multiplier les rencontres avec Shakespeare...
*
La
suite est à retrouver dans les Sonnets.

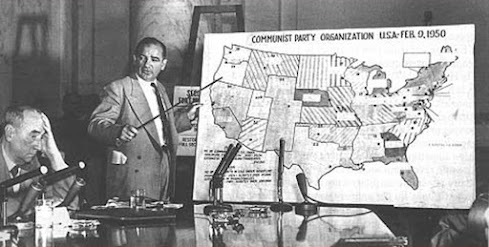


Commentaires
Enregistrer un commentaire