Morale provisoire
La droiture
I am that I am, and they that level
At my abuses reckon up their own ;
I may be straight though they
themselves be bevel.
Je suis qui
je suis ; ceux qui mettent en joue
Mes errements ne font que
recenser les leurs.
Peut-être suis-je droit quand
ils sont tous obliques.
Sonnet
121.
Le mot « droiture » est
désuet. Mes contemporains le comprennent-ils encore ? Le mot est
rare : a-t-il un synonyme ? Devant l’expansion de l’imprévisibilité,
dont les nouveaux tyrans se font une arme, la droiture représente la plus belle
attitude qui soit. Il résonne avec confiance, fidélité, « parole
donnée », « promesse tenue ». C’est un concept magnifique, il
est miraculeux quand il est respecté. On représente toujours le fourbe le dos
courbé. L’homme droit inspire le respect.
J’ai toujours mis la droiture dans la liste prioritaire de mes principes
ou de ma « morale provisoire », comme l’appelait Descartes. J’ai
enseigné la droiture à mes enfants, à mes élèves… Je l’ai exigée de moi-même.
Dans mon enseignement, rien n’était dissimulé, je disais ce que je faisais, je
respectais mes élèves comme des personnes d’égale dignité à la mienne, et je
leur ai toujours rendu ce qui leur revenait : leurs devoirs, leur image
parfaite. La droiture n’est pas un principe qui empêche l’affection, au
contraire, j’ai ainsi pu faire mienne la belle phrase de François Truffaut : « …pouvoir
vivre normalement, c’est-à-dire aimer sans méfiance. » Les enfants
possèdent cette qualité innée, qu’en font les adultes ?

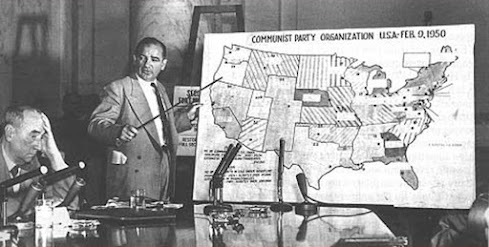


N'est-ce pas Alexandre Dumas père qui a dit "Comment se fait-il que les enfants étant si intelligents, la plupart des hommes soient bêtes ? Cela doit tenir à l'éducation" ?
RépondreSupprimer